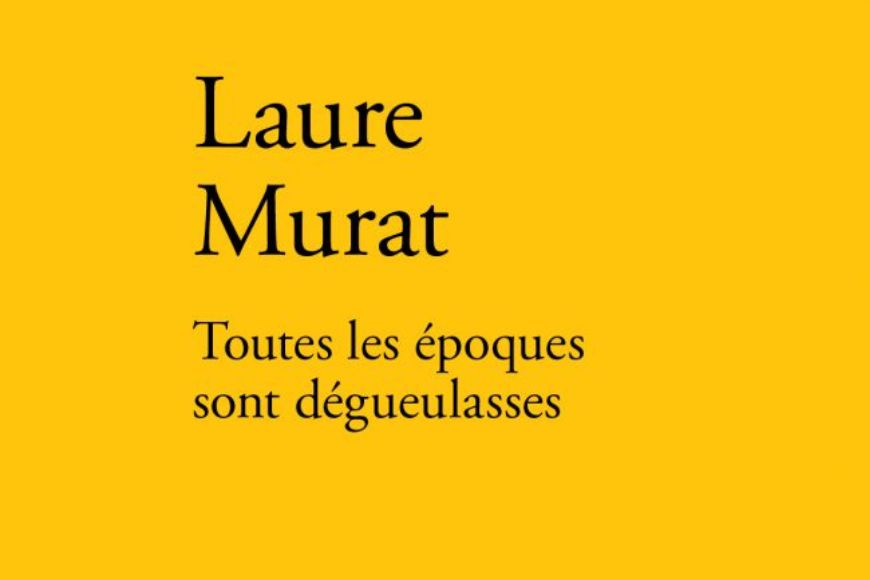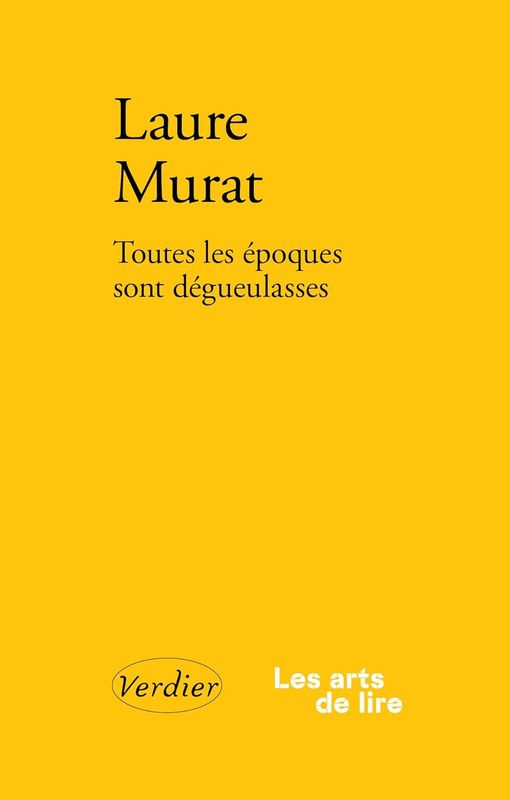
Quatrième de couverture : Depuis quelques années, un malaise s’est installé dans la culture contemporaine. Ici on récrit les classiques pour les purger du racisme et du sexisme, ailleurs on en appelle à une surenchère de contextualisations et on s’appuie sur des sensitivity readers (démineurs éditoriaux). Et si la question qui sous-tend ce vaste débat était mal posée ? S’il s’agissait, dans bien des cas, d’argent et non d’éthique ? Si la censure n’était pas du côté qu’on croit ? Si les précautions prises à tout contextualiser produisaient à terme un effet pervers ?
À l’aide d’exemples concrets et finement analysés, notamment des œuvres de Ian Fleming, Agatha Christie, Roald Dahl, Hergé, Claire de Duras ou encore Mark Twain, Laure Murat tente de rebattre les cartes d’une polémique qui, à force d’amplifier, brouille les vrais enjeux de la création et de sa dimension politique.
Avis : Sorti en mai 2025 chez Verdier, ce tout petit livre s’ouvre sur des questions très actuelles : « Faut-il réécrire les classiques de la littérature ? », « Doit-on réécrire nos livres pour ne pas offenser les sensibilités ? », « Faut-il adapter les classiques à leur époque ? » Elles sont posées dès la première page et permettent à Laure Murat de déployer ensuite tout son argumentaire.
D’ailleurs, ne vous fiez pas trop à la quatrième de couverture qui semble tout rejeter et ne pas prendre position. Certes, aujourd’hui, ce sont essentiellement deux camps qui s’affrontent : celui de la récriture ou de l’interdiction pour ménager la sensibilité des lecteurices, au risque d’effacer l’histoire des oppressions au passage, et celui de la contextualisation qui tend un peu trop à dédouaner l’auteur ou l’autrice, alors qu’on en attendrait plus de neutralité et d’honnêteté intellectuelle. Les exemples concrets sur lesquels s’appuie l’autrice sont judicieux et permettent d’apporter de la nuance. En multipliant les cas de figure, elle propose tout autant de solutions afin d’aborder les œuvres sans œillères ni flou artistique.
Ce qui est avancé dans ce livre apparaîtra comme évident et plein de bon sens à beaucoup de monde, mais son existence même prouve bien que rien n’est si simple. Le sujet est vaste, les positions parfois fermes, les antagonismes très forts. Comme le dit l’autrice en introduction, elle veut surtout proposer une pause, un temps de réflexion pour « comprendre les arguments de l’œuvre et mettre au jour les vraies motivations sous les prétextes idéologiques et bavards ». Le temps de lire 66 pages.
On comprend facilement où se situe la ligne de partage des eaux : la réécriture relève de l’art et de l’acte créateur, la récriture de la correction et de l’altération.
Dans un article de février 2022, Joanne Harris […] soulignait « qu’on ne s’offusque pas des auteurs de polars qui consultent des détectives ou de ceux qui interrogent les professionnels de santé avant d’écrire sur l’hôpital. “Quand on écrit sur le handicap, la transidentité, les sans-abris, les prostitué·es, d’autres ethnies ou cultures, on peut trouver utile de consulter des personnes qui ont plus d’expérience” ».
C’est ce que j’appellerai la frontière délicate entre le « safe space » (l’idée que le campus doit être un espace sûr, respectueux et bienveillant, notamment pour les populations discriminées) et la « confort zone » (cette zone de confort intellectuel qui condamne en vertu d’une sorte d’orthopédie mentale les sujets épineux).
Informations sur l’édition :
Format poche
Éditeur : Verdier
Sortie : 8 mai 2025
80 pages
ISBN : 978-2-37856-253-3
Prix : 7,50 €
Disponible en numérique : 6,49 €